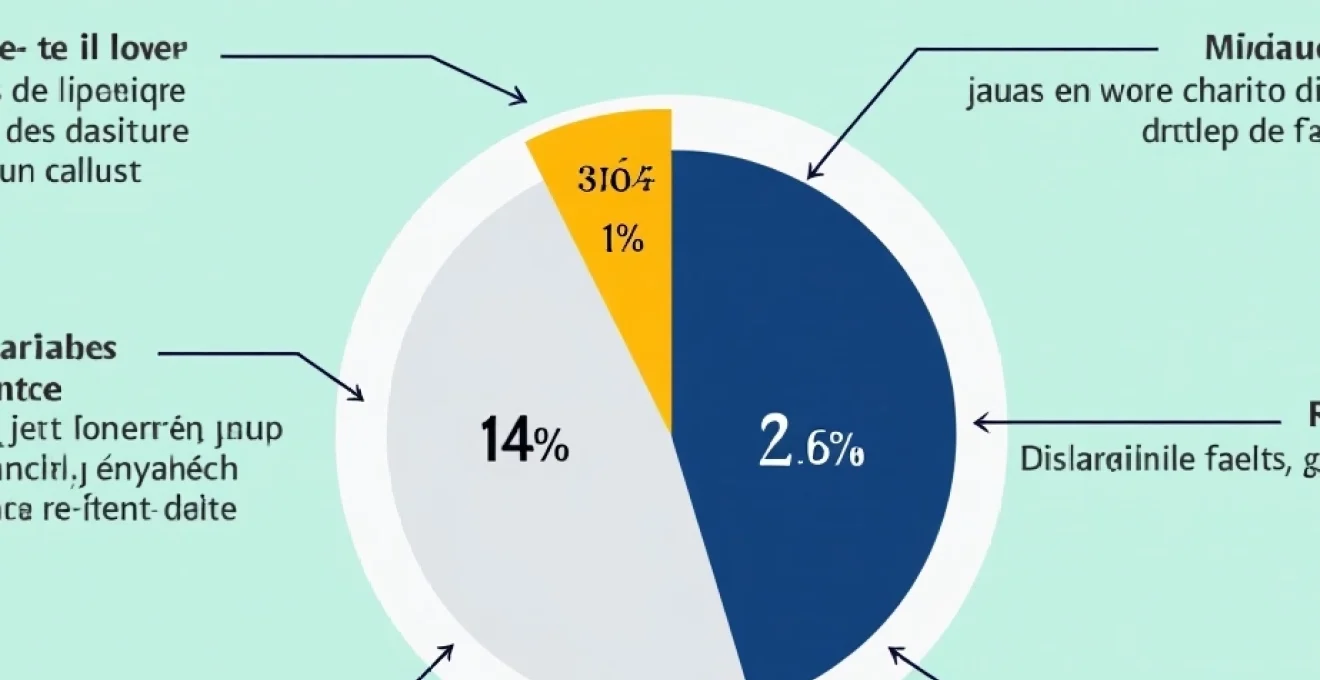
Le droit du travail français distingue deux grandes catégories de licenciement : le licenciement économique et le licenciement pour faute. Ces deux procédures, bien que conduisant toutes deux à la rupture du contrat de travail, répondent à des logiques juridiques très différentes. Comprendre ces distinctions est crucial tant pour les employeurs que pour les salariés, car elles impactent directement les droits et obligations de chacun. Entre motifs invocables, procédures à suivre et conséquences pour le salarié, les nuances sont nombreuses et parfois subtiles. Examinons en détail ces différences juridiques essentielles qui façonnent le paysage du licenciement en France.
Fondements juridiques des licenciements économiques et pour faute
Le licenciement économique et le licenciement pour faute reposent sur des bases légales distinctes, reflétant la nature fondamentalement différente de ces deux situations. Le licenciement économique est défini par l’article L. 1233-3 du Code du travail. Il intervient pour des motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification du contrat de travail refusée par le salarié. Ces changements doivent être consécutifs à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à la cessation d’activité de l’entreprise.
En revanche, le licenciement pour faute s’inscrit dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l’employeur, régi par les articles L. 1331-1 et suivants du Code du travail. Il sanctionne un comportement fautif du salarié, constituant une violation de ses obligations professionnelles. La faute peut être de nature diverse : manquements aux règles de discipline, inexécution ou mauvaise exécution du travail, actes d’insubordination, etc.
Cette distinction fondamentale impacte l’ensemble de la procédure de licenciement, de sa justification à ses conséquences pour le salarié. Par exemple, dans le cas d’un licenciement économique, l’employeur devra démontrer la réalité des difficultés économiques ou des changements technologiques invoqués. Pour un licenciement pour faute, il devra prouver l’existence et la gravité de la faute reprochée au salarié.
Procédures légales spécifiques au licenciement économique
Le licenciement économique obéit à une procédure particulièrement encadrée, visant à protéger les salariés et à s’assurer que toutes les alternatives ont été envisagées. Cette procédure varie selon le nombre de salariés concernés et la taille de l’entreprise, mais certains éléments restent constants.
Tout d’abord, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, au cours duquel il expose les motifs du licenciement envisagé. Cet entretien est une étape cruciale, permettant un échange direct entre l’employeur et le salarié sur la situation de l’entreprise et les possibilités de reclassement.
Ensuite, l’employeur doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit préciser les motifs économiques du licenciement et mentionner la priorité de réembauche dont bénéficie le salarié pendant un an. La priorité de réembauche est un droit spécifique au licenciement économique, obligeant l’employeur à proposer en priorité au salarié licencié tout emploi compatible avec sa qualification qui deviendrait disponible dans l’année suivant son licenciement.
Critères de l’ordre des licenciements selon la loi macron
La loi Macron a apporté des modifications significatives aux critères d’ordre des licenciements économiques. Ces critères déterminent quels salariés seront prioritairement touchés par le licenciement économique lorsque celui-ci concerne plusieurs postes similaires. L’employeur doit définir ces critères en tenant compte :
- Des charges de famille, en particulier celles des parents isolés
- De l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise
- De la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile
- Des qualités professionnelles appréciées par catégorie
Ces critères doivent être appliqués de manière objective et non discriminatoire. La loi Macron a renforcé la flexibilité pour les employeurs en leur permettant de privilégier certains critères, notamment les qualités professionnelles, tout en respectant les autres critères légaux.
Obligation de reclassement et plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
L’obligation de reclassement est une spécificité majeure du licenciement économique. Avant de procéder au licenciement, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient. Cette recherche doit être active et personnalisée, tenant compte des compétences du salarié et des postes disponibles.
Pour les entreprises d’au moins 50 salariés qui envisagent le licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours, la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) est obligatoire. Le PSE doit contenir des mesures visant à éviter les licenciements ou en limiter le nombre, telles que :
- Des actions de reclassement interne
- Des créations d’activités nouvelles
- Des actions de formation ou de reconversion
- Des mesures d’aide à la recherche d’un nouvel emploi
Le PSE est soumis à la validation de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), anciennement DIRECCTE, qui vérifie sa conformité aux dispositions légales.
Rôle de la DIRECCTE dans la validation du motif économique
La DREETS (ex-DIRECCTE) joue un rôle central dans la procédure de licenciement économique, particulièrement pour les licenciements collectifs. Elle intervient pour :
Valider l’accord collectif portant sur le PSE ou homologuer le document unilatéral de l’employeur en l’absence d’accord. Cette validation ou homologation est une condition sine qua non pour que l’employeur puisse procéder aux licenciements.
Vérifier la régularité de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel. La DREETS s’assure que les instances représentatives ont été correctement informées et consultées tout au long du processus.
Contrôler le contenu du PSE, notamment la pertinence des mesures proposées au regard de la situation de l’entreprise et des salariés concernés. Elle peut demander des compléments d’information ou des modifications du plan si elle l’estime insuffisant.
L’intervention de la DREETS ajoute une couche de contrôle administratif au processus de licenciement économique, visant à garantir le respect des droits des salariés et la légalité de la procédure.
Caractéristiques du licenciement pour faute
Le licenciement pour faute se distingue fondamentalement du licenciement économique par son caractère individuel et disciplinaire. Il sanctionne un comportement fautif du salarié dans l’exécution de son contrat de travail. Contrairement au licenciement économique, qui résulte de facteurs externes, le licenciement pour faute est directement lié aux actions ou omissions du salarié.
La procédure de licenciement pour faute, bien que plus simple que celle du licenciement économique, reste néanmoins encadrée par le Code du travail. Elle débute généralement par une convocation à un entretien préalable, suivie de l’entretien lui-même, puis de la notification du licenciement. Cependant, les obligations de l’employeur en termes de reclassement ou de mise en place d’un PSE ne s’appliquent pas dans ce cas.
Distinction entre faute simple, grave et lourde
Le droit du travail français distingue trois niveaux de faute pouvant justifier un licenciement, chacun entraînant des conséquences différentes pour le salarié :
- La faute simple : Elle justifie le licenciement mais n’empêche pas l’exécution du préavis ni le versement des indemnités de licenciement.
- La faute grave : Elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle prive le salarié de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
- La faute lourde : Elle se caractérise par l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. En plus des conséquences de la faute grave, elle peut engager la responsabilité civile du salarié.
La qualification de la faute est cruciale car elle détermine les droits du salarié en termes d’indemnisation. Par exemple, un salarié licencié pour faute simple conservera son droit à l’indemnité de licenciement, contrairement à un salarié licencié pour faute grave ou lourde.
Procédure disciplinaire et entretien préalable
La procédure disciplinaire dans le cadre d’un licenciement pour faute suit des étapes précises :
- Convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.
- Tenue de l’entretien préalable, au cours duquel l’employeur expose les motifs de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
- Notification de la sanction, qui ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables ni plus d’un mois après l’entretien préalable.
L’entretien préalable revêt une importance particulière dans la procédure de licenciement pour faute. Il permet au salarié de se défendre face aux griefs qui lui sont reprochés et à l’employeur d’évaluer la proportionnalité de la sanction envisagée. Le salarié peut se faire assister lors de cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence de représentants du personnel, par un conseiller du salarié .
Délais de prescription des fautes selon la jurisprudence
La jurisprudence a établi des règles concernant les délais dans lesquels une faute peut être sanctionnée. Le principe général est que l’employeur doit agir dans un délai raisonnable après avoir eu connaissance des faits fautifs. Ce délai est apprécié au cas par cas par les tribunaux, mais quelques lignes directrices se dégagent :
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Pour les faits anciens, la Cour de cassation considère généralement qu’un délai de deux mois entre la connaissance des faits par l’employeur et l’engagement de la procédure disciplinaire est raisonnable. Au-delà, l’employeur risque de se voir opposer la prescription des faits.
Cependant, en cas de faits répétés ou continus, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier fait fautif. Cette règle permet à l’employeur de sanctionner des comportements qui s’inscrivent dans la durée.
Indemnités et droits des salariés selon le type de licenciement
Les indemnités et droits des salariés varient significativement selon qu’il s’agit d’un licenciement économique ou d’un licenciement pour faute. Cette différenciation reflète la volonté du législateur de protéger davantage les salariés victimes de circonstances économiques indépendantes de leur volonté, tout en permettant aux employeurs de sanctionner les comportements fautifs.
Dans le cas d’un licenciement économique, le salarié bénéficie généralement de l’ensemble des indemnités prévues par le Code du travail : indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis (même si celui-ci n’est pas exécuté), et indemnité compensatrice de congés payés. De plus, des dispositifs spécifiques comme le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) peuvent être proposés aux salariés des entreprises de moins de 1000 salariés.
En revanche, pour un licenciement pour faute, les droits du salarié dépendent de la qualification de la faute. Une faute simple n’affecte pas les droits aux indemnités, tandis qu’une faute grave ou lourde prive le salarié de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Barème macron pour les indemnités prud’homales
Le barème Macron , introduit par les ordonnances de septembre 2017, encadre les indemnités prud’homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce barème fixe des planchers et des plafonds d’indemnisation en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise. Par exemple :
| Ancienneté du salarié | Indemnité minimale | Indemnité maximale |
|---|---|---|
| Moins de 1 an | Pas de minimum |
Ce barème s’applique à tous les licenciements, qu’ils soient économiques ou pour faute, dès lors qu’ils sont jugés sans cause réelle et sérieuse. Cependant, il ne s’applique pas dans certains cas particuliers, notamment les licenciements nuls (discrimination, harcèlement, etc.) où le juge n’est pas tenu par ces plafonds.
L’introduction de ce barème a suscité de vives controverses. Ses partisans arguent qu’il apporte plus de prévisibilité aux employeurs et favorise les accords amiables, tandis que ses détracteurs estiment qu’il limite le pouvoir d’appréciation des juges et peut conduire à une sous-indemnisation des salariés dans certains cas.
Calcul des indemnités de licenciement économique
Le calcul des indemnités de licenciement économique obéit à des règles spécifiques, plus favorables au salarié que celles applicables au licenciement pour faute. L’indemnité légale de licenciement est calculée comme suit :
- 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans
- 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans
Par exemple, un salarié avec 15 ans d’ancienneté et un salaire mensuel brut de 2500€ percevra une indemnité de :
(10 x 2500 x 1/4) + (5 x 2500 x 1/3) = 6250€ + 4166€ = 10416€
Il est important de noter que certaines conventions collectives peuvent prévoir des indemnités plus avantageuses. Dans ce cas, c’est le calcul le plus favorable au salarié qui s’applique.
Droits à l’assurance chômage et au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
Les droits à l’assurance chômage diffèrent selon le type de licenciement. Dans le cas d’un licenciement économique, le salarié bénéficie automatiquement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), sans délai de carence, à condition de s’inscrire comme demandeur d’emploi.
De plus, les salariés licenciés pour motif économique dans une entreprise de moins de 1000 salariés (ou en redressement ou liquidation judiciaire) peuvent bénéficier du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP). Le CSP offre :
- Un accompagnement renforcé pour le retour à l’emploi
- Une allocation spécifique de sécurisation professionnelle (ASP) plus avantageuse que l’ARE classique
- Des aides à la formation et à la création d’entreprise
En cas de licenciement pour faute, le salarié peut également bénéficier de l’ARE, mais des délais de carence peuvent s’appliquer, notamment en cas de versement d’indemnités supra-légales.
Contentieux et recours judiciaires spécifiques
Les litiges liés aux licenciements, qu’ils soient économiques ou pour faute, peuvent donner lieu à des contentieux devant les juridictions prud’homales. Cependant, les enjeux et les procédures peuvent varier selon la nature du licenciement.
Compétence du conseil de prud’hommes et délais de saisine
Le Conseil de Prud’hommes est compétent pour traiter les litiges individuels liés au contrat de travail, y compris les contestations de licenciement. Le délai de saisine du Conseil est de 12 mois à compter de la notification du licenciement, que ce soit pour un licenciement économique ou pour faute.
Cependant, en cas de licenciement économique collectif avec PSE, la contestation de la décision de validation ou d’homologation du PSE par la DREETS relève de la compétence du tribunal administratif. Le délai de recours est alors de 2 mois.
Charge de la preuve dans les litiges pour licenciement abusif
La charge de la preuve est répartie différemment selon le type de licenciement :
- Pour un licenciement économique, l’employeur doit prouver la réalité des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
- Pour un licenciement pour faute, l’employeur doit démontrer la réalité et la gravité de la faute reprochée au salarié.
Dans les deux cas, le juge exerce un contrôle sur le caractère réel et sérieux du motif invoqué. Si le doute subsiste, il profite au salarié, conformément à l’article L. 1235-1 du Code du travail.
Jurisprudence de la cour de cassation sur les motifs réels et sérieux
La Cour de cassation a développé une jurisprudence abondante sur la notion de cause réelle et sérieuse, tant pour les licenciements économiques que pour les licenciements pour faute. Quelques exemples marquants :
- Pour le licenciement économique, la Cour a précisé que les difficultés économiques s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise (Cass. soc., 16 novembre 2016, n° 15-19.927).
- Concernant le licenciement pour faute, la Cour a jugé qu’une insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. L’employeur doit démontrer une faute imputable au salarié (Cass. soc., 3 février 2021, n° 19-19.673).
Ces décisions illustrent la complexité de la matière et l’importance d’une analyse au cas par cas des situations de licenciement.
En conclusion, les différences juridiques entre licenciement économique et licenciement pour faute sont substantielles, tant dans leurs fondements que dans leurs procédures et leurs conséquences. Cette distinction reflète la volonté du législateur d’adapter le droit du travail aux diverses réalités économiques et professionnelles, tout en cherchant un équilibre entre la protection des salariés et la flexibilité nécessaire aux entreprises.